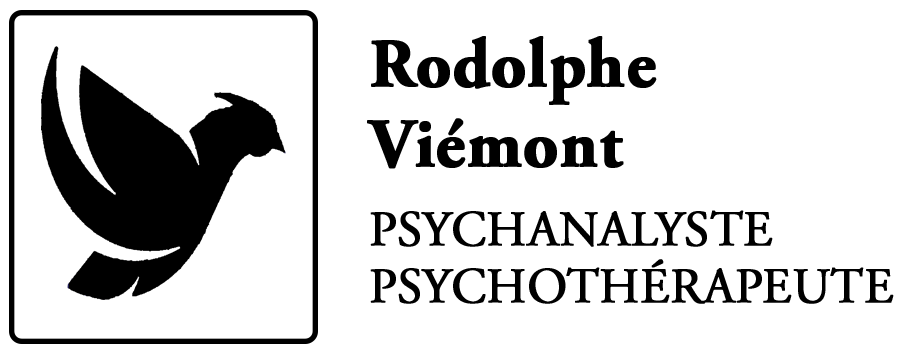par Roland Chemama
Suffit-il qu’une personne en difficulté vienne consulter un analyste pour qu’on puisse s’assurer qu’une cure va bien commencer ? Certainement pas, et on peut même estimer que la question, de nos jours, prend une acuité particulière. Est-ce un signe de plus que la clinique se transforme ? Ou bien est-ce que seules les formes de la demande auraient changé, et non les entités cliniques elles-mêmes ? Quoi qu’il en soit, la majorité des analystes semblent à présent particulièrement attentifs à la question des débuts d’une cure[1].
HIER
Comment une analyse commence-t-elle ? Par quelques entretiens entre l’analyste et l’analysant, qui précèdent la décision de mettre en place ce type particulier de travail. Ces entretiens se font en face-à-face, mais quoi d’autre ? Quel est leur but ? Quelle importance leur accorder ? Combien de temps les prolonger ?
Il fut un temps où les analystes cherchaient à statuer sur « l’analysabilité » de la personne qui venait les consulter. Cette préoccupation semble avoir disparu, même si, en tentant de découvrir s’il n’y a pas quelque risque de psychose, l’analyste se repère du même coup sur la conduite de la cure, à commencer par la possibilité ou non d’allonger le patient. Mais quoi d’autre ?
Il semble bien qu’il y a quelques décennies, la tendance générale était d’en venir aussitôt que possible à ce que l’on concevait comme l’essentiel du travail analytique. Ce n’est pas qu’on ignorait la nécessité, dans certains cas, d’une étape préalable. Mais celle-ci était conçue comme très brève. Repensons à cet égard à l’analyse que propose Lacan des premiers entretiens de Freud avec Dora. Celle-ci se plaint de l’odieux échange dont elle serait l’objet. Son père et Mme K. sont amants et cela conduit son père à l’offrir sans défense aux assiduités de M. K. Freud commence alors par faire percevoir à la jeune fille qu’elle-même, par son silence et sa complicité, a pris une part active à la relation des deux amants.
On trouvera dans « La direction de la cure », de Lacan[2], une présentation de ce temps préalable : « A-t-on observé […] que ce qui nous étonne comme une endoctrination préalable tient simplement à ce qu’il [Freud] procède exactement dans l’ordre inverse. À savoir qu’il commence par introduire le patient à un premier repérage de sa position dans le réel […] Il ne s’agit guère de l’y adapter, mais de lui montrer qu’elle n’y est que trop bien adaptée, puisqu’elle concourt à sa fabrication. »
Mais, ajoute alors Lacan : « Ici s’arrête le chemin à parcourir avec l’autre. Car déjà le transfert a fait son œuvre, montrant qu’il s’agit de bien autre chose que des rapports du Moi au monde. »
De quoi s’agit-il dans la cure ? Des rapports du sujet, entendu comme sujet de l’inconscient, à son fantasme et à l’objet cause de son désir. Et tout se passe comme si, classiquement, l’analyste était pressé d’en venir à ce niveau, considérant comme inutile, voire préjudiciable, à la conduite de la cure, un arrêt trop long sur ce repérage de la position du patient à l’égard de la réalité. Ne risque-t-on pas, si on s’y attarde, de croire que ce temps préliminaire constitue le temps essentiel de l’analyse ?
DE NOS JOURS
Il est rare, de nos jours, qu’un début d’analyse ait la sobriété de ce premier dialogue entre Freud et Dora. L’analyste, assez souvent, ne peut éviter de se poser une question préalable à l’engagement du travail, parce que son expérience lui a appris à mesurer les difficultés auxquelles il aura affaire. Est-ce que, dans la demande qui lui est adressée, ne se cache pas, comme un germe d’échec possible, quelque chose qui compromet, à l’avance, le travail analytique ? Il ne s’agit pas d’adopter une méfiance systématique, mais une illusion sur la facilité de l’entreprise peut amener bien des maladresses. Ce qui peut faire difficulté, cependant, nous le situons de diverses manières. Cela peut être, comme autrefois, mais plus qu’autrefois, la demande d’une « guérison » immédiate. Dans un monde soucieux d’évaluer l’efficacité de toute pratique, un tel espoir se conçoit. Reste qu’il détourne du travail patient de la cure.
Ce peut être aussi une façon, paradoxale chez ceux qui vont consulter un psychanalyste, de laisser entendre que de ce qui sera dit par lui, on n’en croira pas un mot. Ainsi à la première ébauche d’interprétation : « C’est normal que vous disiez cela… puisque vous êtes psychanalyste ». Il y a là un état d’esprit bien banal aujourd’hui, une défiance de principe qui reflète peut-être le désarroi du sujet contemporain. Celui-ci, qui a pu mesurer la faillite des grandes idéologies, a adopté le parti de se défier de tout.
Ce peut être enfin, et plus fondamentalement, un rapport au langage qui le rabat sur un simple moyen de communication. Le langage, ici, n’a plus d’épaisseur. Un mot exprime une idée et une seule, et toute dimension métaphorique se trouve exclue. Cela s’accorde certainement avec l’espoir contemporain de maîtriser les choses en maîtrisant les mots. Mais on sait que seule l’attention aux connotations de la parole permet d’approcher le désir inconscient.
Ces différents obstacles ne sont pas forcément rédhibitoires, mais ils impliquent sans doute une sorte de travail préalable à ce qui, dans la cure, vaudra comme interprétation. Travail de lente remise en question des présupposés de la demande. Mais peut-être surtout travail introduisant à la dimension des formations de l’inconscient, telle qu’elle apparaît dans sa temporalité particulière.
COMMENT FAIRE ?
Une demande, aujourd’hui plus qu’hier probablement, doit s’élaborer peu à peu, ou tout au moins doit se dégager des a priori que le sujet contemporain véhicule avec lui. Il n’y a pas, à cet égard, de façon type de procéder, mais l’analyste pourra être attentif à ce qui, chez le patient qu’il reçoit, renvoie à des particularités sociales ou familiales, voire professionnelles, dont celui-ci pourrait percevoir, sans forçage, l’effet aliénant. Ainsi il n’est pas rare que des personnes qui sont chargées, dans une entreprise, de veiller à l’efficacité de toutes les démarches (à leur rapidité par exemple) aient eu l’occasion, dans ce contexte, de percevoir à quel point un tel projet peut être contraignant, à quel point il peut raboter tout autre souci, à commencer par celui de la qualité. L’analyste peut alors aisément s’appuyer là-dessus pour faire valoir que lorsqu’il s’agit de la subjectivité, les conséquences du principe d’efficacité risquent d’être plus déplorables encore.
De même un sujet qui disqualifie la parole qu’il va pourtant solliciter, celle d’un analyste, peut être confronté à ce que cela a de paradoxal – à condition bien sûr que ce qui lui est alors dit ne passe pas pour une accusation.
C’est toutefois le plan des rapports du sujet au langage qui est décisif. Et là il ne s’agit pas seulement de décons- truire, mais peut-être de construire, c’est-à-dire d’amener, dans les premières séances, une sorte d’anticipation, une anticipation qui fasse un peu sortir de ce que l’analysant installe comme limites de sa compréhension. C’est à partir de cette anticipation, qui se présente fréquemment comme un jeu de mots, que l’analysant, revenant sur ce qu’il a dit, peut l’entendre d’une autre façon. Il y a là une dimension d’après-coup qui est la marque même du dévoilement de l’inconscient. Ajoutons que ce qui se passe là renvoie également au jeu toujours subtil entre savoir et non-savoir. Or même si l’analyste privilégie la dimension du savoir inconscient, ce jeu dépend aussi du contexte culturel dans lequel se fait l’analyse.
QUEL SAVOIR ?
Quand l’homme aux rats consulte Freud, il fait état d’une période où ses troubles obsessionnels ont diminué ; et il croit devoir indiquer à Freud que c’est parce que, à cette époque, il avait des rapports sexuels réguliers. Sans doute le fait-il par complaisance envers Freud : ayant lu, plus ou moins attentivement, deux de ses livres, il a cru pouvoir tirer de cette lecture une indication sur l’étiologie des névroses, et les moyens de les apaiser. Peu importe d’ailleurs que dans cet exemple l’analysant fasse état d’un accord avec son analyste, et que dans d’autres cas, plus actuels, il affirme son désaccord. connaître, l’analysante se présente à l’analyste en position de posséder un savoir suffisant pour discuter avec celui-ci de la théorie freudienne, plus précisément de l’idée d’une transposition possible entre pénis et enfant. « Je n’ai jamais vu, lui dit-elle dès la première séance, de lien palpable entre l’enfant et le phallus. » « Palper le phallus » se contente de dire l’analyste, ce qui peut faire entendre un désir bien éloigné des discussions académiques auxquelles l’analysante est en train de se livrer. L’analyste, ensuite, durant de longs mois, se montrera plus silencieux. Mais cette intervention, qui prend de vitesse ce que l’analysante pourra élaborer, cette intervention qu’on pourrait croire prématurée, a le mérite de montrer d’emblée que toute tentative de rabattre l’analyse sur un savoir théorique laisse échapper le plus vif des manifestations de l’inconscient.
Peut-être peut-on par ailleurs, au terme de ces remarques, souligner que le début d’une psychanalyse, aujourd’hui, conduit fréquemment à donner une attention particulière à la question du temps dans son ensemble. L’analyse ne peut sans doute pas fonctionner hors d’une dialectique entre l’anticipation foudroyante de l’interprétation, et le temps plus long de l’élaboration, qu’elle précède d’une certaine façon, même si elle intervient aussi, assez souvent, dans un après-coup qui éclaire d’une lumière vive ce qui jusqu’alors s’est développé dans l’ombre. Est-ce pour cela que le sujet contemporain peut avoir plus de mal à entrer dans cette démarche ? La temporalité propre à notre monde, c’est celle d’un présent détaché du passé comme de l’avenir, parce que le sujet ne se reconnaît plus dans un passé qu’il récuse, et qu’il ne peut pas davantage envisager le développement des virtualités du présent dans le futur. Cela pose certainement des problèmes spécifiques.
Roland CHEMAMA (Christiane LACÔTE-DESTRIBATS, Bernard VANDERMERSCH), Le métier de psychanalyste, Toulouse : érès, 2016.
Acheter le livre : https://www.cairn.info/le-metier-de-psychanalyste–9782749249728.htm
[1] Ce chapitre reprend dans ses grandes lignes un article publié dans la revue La clinique lacanienne, n° 24, 2014. Ce numéro, portant sur « les débuts d’une analyse », était coordonné par Gorana Bulat- Manenti.
[2] J. Lacan, Écrits, paris, Le Seuil, 1966.