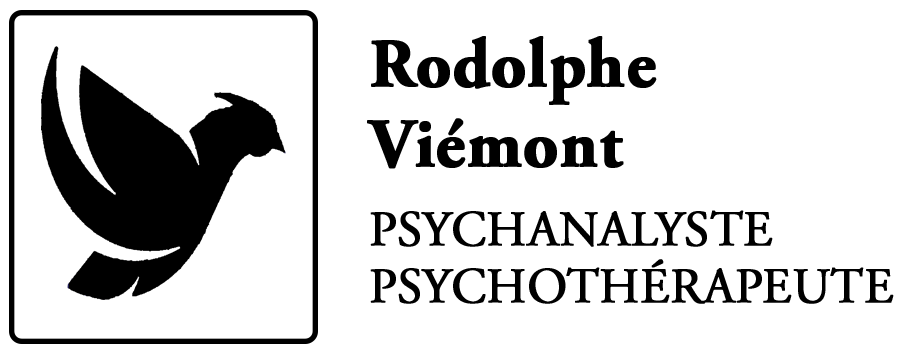par Sara Tetzchner
En médecine, la psychose s’explique comme un excès de dopamine, un esprit surexcité par ses propres signaux. Mais si le même déséquilibre s’appliquait à la culture ? Nous vivons dans une société saturée de dopamine.
La société comme structure psychotique
Le « normal » n’est peut-être que celui qui partage la psychose du plus grand nombre. Si l’individu psychotique croit que le monde lui parle directement, notre époque semble marquée par le même mécanisme, mais à l’échelle collective. Jacques-Alain Miller parle de la psychose ordinaire, cette psychose devenue banale. Autrefois, la psychose représentait une rupture exceptionnelle dans le rapport du sujet à la réalité. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où tout parle, tout le temps : écrans, publicités, notifications, voix, algorithmes. Chaque message exige une réponse, chaque image appelle une réaction. Le monde extérieur est devenu un cri continu pour capter notre attention.
Cette surcommunication ne produit pas plus de sens, mais moins. Quand tout doit signifier quelque chose, le sens lui-même perd son poids. Comme Narcisse, nous voyons notre reflet partout ; comme Écho, nous ne répondons que par répétition, un dialogue sans distance et sans silence. Le langage n’est plus un médium pour comprendre, mais un écho de lui-même, un miroir où l’homme cherche désespérément un éclat de réel. Dans cette cacophonie de signes et de stimuli, le symbolique perd sa force d’organisation. L’homme reste seul face à son reflet, privé d’un langage capable de le porter.
Ainsi, la société commence à ressembler à la structure psychotique. Elle manque d’une référence commune, mais surproduit du sens pour combler le vide. Le conspirationnisme, le narcissisme, les algorithmes autoréférentiels et l’économie dopaminique des réseaux sociaux convergent vers la même tentative : reconstruire un ordre perdu. Là où le psychotique entendait des voix, nous recevons des notifications. Là où il voyait des signes dans la rue, nous déchiffrons des motifs sur nos écrans.
Nous vivons tous avec ce sentiment diffus d’être observés, manipulés, à la fois invisibles et surexposés, comme si le monde en savait plus sur nous que nous-mêmes. Et dans ce malaise se glisse aussi le désir : être vus, mesurés, reconnus. Nous cherchons le Grand Autre que nous avons détruit.
La psychose de notre temps n’apparaît donc pas comme une catastrophe individuelle, mais comme un symptôme collectif. Une société qui parle sans écouter, qui communique sans signifier, qui se croit éveillée alors qu’elle rêve les yeux ouverts.
Schizophrénie numérique
Le philosophe coréen Byung-Chul Han décrit l’ère numérique comme une époque où l’être humain a perdu sa cohérence intérieure. Icare, fils de Dédale, s’enfuit du labyrinthe sur des ailes de cire et de plumes, mais s’éleva trop haut et tomba lorsque le soleil fit fondre ses ailes. Le mythe rappelle la condition de l’homme moderne, qui perd la mesure dans sa propre ascension, lorsque la lumière devient ivresse et la hauteur, chute.
Dans la lumière constante des écrans et des notifications, il n’existe plus d’espace pour le silence, la réflexion ou la lenteur. Tout est visible, tout est immédiat, tout doit être communiqué. Dans cette réalité surexposée, le moi se fragmente et se dissout en instants d’attention sans durée. Han appelle cela la schizophrénie numérique, une condition culturelle où la pensée n’a plus le temps de se penser elle-même, où l’expérience ne devient jamais expérience parce que tout doit être partagé aussitôt. L’homme vit à la surface de lui-même, constamment actif, mais privé de vie intérieure.
Le monde paranoïaque
À mes yeux, la paranoïa n’est pas seulement une forme de folie, mais une tentative de sauver le moi de la désintégration. Ce que l’on appelle paranoïa n’est pas un vide de sens, mais un travail désespéré de production de sens.
Chez un patient X, on peut observer cela clairement. Il dirige sa colère contre un autre homme qu’il perçoit comme menaçant ou moqueur, mais cet autre n’est en réalité qu’une image de lui-même. Il réagit contre la part de lui qu’il sent jugée, contre sa fierté, sa honte, sa faiblesse, son insuffisance. Ses gestes deviennent symboliques, comme s’il tentait de détruire un reflet qu’il ne supporte pas de voir. La dimension paranoïaque apparaît ici comme une tentative dramatique de restaurer un moi en voie d’effondrement.
Chez le paranoïaque, il se produit un déplacement : l’intérieur est projeté vers l’extérieur. Tout ce qui ne peut être contenu dans le moi devient un « quelqu’un là-bas » qui contrôle, observe, se moque ou parle de moi. L’expérience paranoïaque naît comme l’écho de cette projection :
Ils parlent de moi.
Ils rient de moi.
Tout ce qui arrive a quelque chose à voir avec moi.
Cela peut sembler irrationnel, mais c’est en réalité l’effet d’un mécanisme profondément humain. Quand le lien avec l’ordre symbolique, le langage, la communauté, l’Autre garant du sens, se rompt, le monde commence à parler. Il parle directement, sans intervalle, sans filtre symbolique. C’est pourquoi le psychotique entend des voix ou voit des signes partout. Ce n’est pas qu’il interprète mal la réalité, mais que la réalité elle-même a perdu son échafaudage de sens.
La paranoïa n’existe pas seulement chez l’individu. Elle vit aussi dans la culture, et c’est peut-être là qu’elle se manifeste le plus clairement. Une société devient paranoïaque lorsqu’elle perd foi en son autorité symbolique, en Dieu, en la nation, en la vérité. Quand il n’existe plus de référence commune, tout devient affaire de soupçon, de contrôle et d’intentions cachées. Le complotisme et la mentalité du « tous contre tous » surgissent quand le langage et la confiance s’effondrent.
En Europe, cette nouvelle paranoïa s’étend. La France prolonge la vidéosurveillance algorithmique jusqu’en 2027, la Norvège adopte une loi sur la sécurité numérique renforçant le contrôle de l’État, et les drones dans les aéroports suscitent la peur de menaces invisibles. Le continent se protège de tout et finit par se surveiller lui-même. Le soupçon n’est plus l’exception, mais le système : une société qui se protège de tout, jusqu’à ne plus se protéger que d’elle-même.
Aux États-Unis, le même schéma se déploie, mais de manière plus extrême. Le soupçon est devenu une part de l’identité nationale, une culture fondée sur la surveillance, la polarisation et la guerre permanente contre un ennemi invisible. L’État collecte les données de ses propres citoyens au nom de la sécurité, tandis que la population répond par des théories du complot, le culte des armes et une méfiance profonde envers les institutions. L’espace politique est transformé en salle des miroirs où vérité et mensonge circulent avec le même poids. L’Amérique se protège de tout, mais à la fin, surtout d’elle-même.
Psychocapitalisme
Franco « Bifo » Berardi montre comment le capital a transformé la vie psychique elle-même en matière première. Le psychocapitalisme n’est pas seulement un système économique, mais un principe. Ce qui relevait autrefois de l’expérience intérieure, de l’attention, du désir et des émotions est désormais intégré dans la logique du marché. L’économie ne produit plus seulement des biens, mais aussi des humeurs, des rythmes et des affects. Le but du capital n’est pas de satisfaire des besoins, mais de maintenir le système nerveux en mouvement. La psychose n’y apparaît donc pas comme une rupture du système, mais comme son moteur : une circulation surchauffée de sens, de dopamine et de communication qui doit sans cesse se renouveler. En ce sens, la psychose n’est pas une erreur de l’économie, mais sa formule : une surchauffe calculée de la vie intérieure de l’homme, garantissant une croissance continue.
Dans L’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari décrivent le capitalisme comme une machine schizophrénique. Il détruit toutes les structures, toutes les lois, toutes les frontières, pour ensuite les reproduire sous forme de marchandises. C’est là que naît le paradoxe : la société craint la psychose, mais l’imite dans son propre rythme. La production de sens, de biens, d’identité et d’information est devenue ininterrompue, sans limite, euphorique. L’état schizophrénique — la dissolution de l’identité, le flux du désir, la perte du centre — n’est plus l’exception, mais la norme. Chez Deleuze et Guattari, la schizophrénie devient la dernière liberté de l’homme, celle qui échappe à toute organisation et crée de nouvelles connexions entre tout ce qui a été brisé.
L’ordre de la folie
La folie est aussi un regard social et historique. Dans L’Histoire de la folie, Foucault écrit que le fou est défini par celui qui détient le langage. Chaque époque possède sa propre forme de raison, et donc sa propre forme de folie. Ce ne sont plus l’Église ou l’asile qui séparent le rationnel de l’irrationnel, mais la technologie et l’économie. Ceux qui ne produisent pas, ne communiquent pas, ne performent pas, sont silencieusement définis comme malades. La psychose devient alors la ligne de partage, celle qui montre qui ne s’intègre pas dans la machine rationnelle du capitalisme. Dans une société qui se croit éclairée, la folie persiste encore, mais sous une forme plus sophistiquée.
Réalité capitaliste
Autrefois, l’homme était prisonnier de la culpabilité et de l’interdit. Aujourd’hui, il est prisonnier de l’illimitation, perdu dans un océan de choix, d’exigences et de responsabilités. Nous sommes libres d’être tout, mais nous n’en avons plus la force. L’effondrement ne se manifeste plus par un cri, mais par un silence, un effacement lent du rythme humain, une hyperfonction déguisée en réussite. Comme l’a écrit Alain Ehrenberg, ce n’est plus l’époque de la névrose, mais celle de la dépression. L’homme se brise non pas parce qu’il est empêché, mais parce que plus rien ne l’empêche.
Mark Fisher décrit le même mécanisme à l’échelle sociale. Il appelle cette condition le réalisme capitaliste, la croyance qu’aucune autre réalité n’est possible. Nous savons que le système nous détruit, mais nous ne parvenons pas à imaginer quoi que ce soit en dehors de lui. Les jeunes ne souffrent plus de culpabilité, mais de vide ; non de l’interdiction, mais de l’absence de sens. C’est un système qui continue de fonctionner longtemps après que l’espoir s’est éteint.
À la fin, il semble, comme l’avait pressenti Baudrillard, que nous vivons dans une forme de psychose simulée. Le monde ne fait que refléter sa propre lumière, une réalité qui ne renvoie plus vers rien d’extérieur, mais se replie lentement sur elle-même. Les signes se sont détachés de la signification, la copie a remplacé l’original, et il ne reste que des miroirs se réfléchissant à l’infini. L’homme joue le rôle principal dans son propre hologramme, entouré d’images qui prétendent pointer vers la vérité, mais ne renvoient qu’à elles-mêmes.
Ce n’est pas la folie au sens classique, mais une psychose parfaitement fonctionnelle, une surface lisse, sans rupture, sans profondeur, sans silence. Peut-être est-ce justement cette stabilité qui est la plus inquiétante : un monde qui ne s’effondre jamais, mais qui a depuis longtemps cessé d’être réel. Comme Arachné, nous avons tissé une image si parfaite qu’elle nous a emprisonnés. La toile que nous filons n’est plus une œuvre d’art, mais une prison.