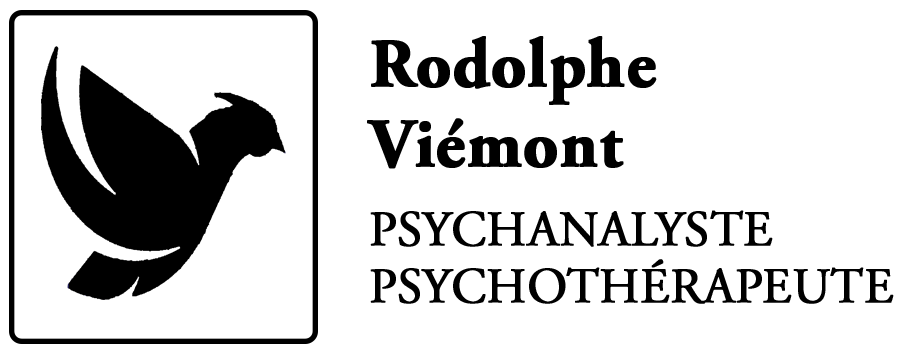Le titre d’état de psychothérapeute sanctionne deux années d’étude post Master 2 (400 heures de formation selon 4 modules et 700 heures de stage en institutions).
Module 1 : Développement, fonctionnement et processus psychiques
Module 2 : Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques
Module 3 : Théories se rapportant à la psychopathologie
Module 4 : Principales approches utilisées en psychothérapie
J’ai fait mes stages à la clinique de Chailles La Chesnaie (41) (psychothérapie institutionnelle adultes) et à l’École expérimentale de Bonneuil (94) (hôpital de jour enfants et adolescents).
J’ai obtenu le diplôme de psychothérapeute (à l’EPhEP – École Pratique des hautes Études en Psychopathologie) en septembre 2024, avec la mention bien, et avec la note de 16 à la soutenance de mémoire de stage.

École Pratique des hautes Études en Psychopathologie
(2022-2024)
Titre du mémoire : « De l’importance de la “place” dans la stabilisation de la psychose maniaco-dépressive«
Professionnel.le.s. (uniquement), vous pouvez demander le mémoire en PDF en remplissant ce formulaire.
Introduction du mémoire
J’ai effectué mon stage à La Chesnaie sur deux ans : deux mois à l’hiver 2023 et deux mois à l’hiver 2024, pour un total de 587 heures. Ma découverte en 2023 de la psychothérapie institutionnelle a été très forte. J’y ai trouvé un mode de pensée et une prise en charge de la pathologie mentale qui ont résonné avec ma sensibilité (et sûrement mon éthique). Un endroit où les barrières entre pensionnaires et moniteurs sont au maximum abolies, où l’ensemble des chesnéens[1] forment, on peut le nommer ainsi, une communauté thérapeutique.
Au sortir du premier stage, j’avais fait le tour de la pratique institutionnelle, mais n’avais pas vraiment eu le temps de mettre en place une prise en charge particulière avec le patient, David Lanne, sur lequel j’avais choisi d’écrire ce mémoire. Il m’a donc semblé logique de revenir en 2024, pour, fort de ce que j’avais appris l’année précédente, commencer un travail plus poussé avec ce pensionnaire maniaco-dépressif.
La question qui me vint très vite s’articulait autour l’importance de la place de David dans sa semi-stabilisation thymique. Je remarquai que David, 74 ans en janvier 2023 (avec des difficultés pour marcher) ne participait plus depuis quelques années aux ateliers et aux activités de la clinique. Qu’est-ce qui, malgré sa non-mobilisation institutionnelle, faisait encore lieu de thérapie ou du moins d’étayage pour lui ? Vivre en groupe ? Rester dans une forme de train-train, ancré au Patio [2]: train-train qui lui sied de prime abord, aujourd’hui encore, mais peut également être source d’ennui, voire occasionner une humeur dépressive à long terme ? Il y a quelque chose d’étrange et de paradoxal dans la vie de David à La Chesnaie : il vit plus de ses souvenirs, avec ses classeurs, ses livres, qu’activement dans la clinique. Mais l’on peut considérer qu’être juste là, à la clinique, est un acte thérapeutique en soi. David est un des plus anciens résidents de La Chesnaie. Il m’a semblé dès lors intéressant de le questionner sur ce qu’a été cette institution pour lui et ce qu’elle est peut-être encore. En quoi le lieu qu’est La Chesnaie (que l’on pourrait majusculer en « Lieu » si on prend en compte son aspect symbolique) est-il pour ses pensionnaires un moyen très efficace de stabilisation, de resocialisation, voire de rémission ? Ou comment, l’air de rien, entre deux discussions informelles au Boissier[3], dans un ensemble architectural et symbolique sans barrière, on vient malgré tout à poser un cadre. Ou comment on fait de la psychiatrie sans en faire…
[1] « Chesnéen » est l’adjectif de « La Chesnaie ». Il indique tant les soignants que les soignés.
[2] Un des cinq bâtiments hospitaliers de la clinique. Voir supra p.13.
[3] Bâtiment appartenant au Club de La Chesnaie, qui abrite le bar de la clinique et est donc un lieu où pensionnaires et moniteurs se retrouvent dans la journée autour d’un café ou d’un soda.
Sommaire
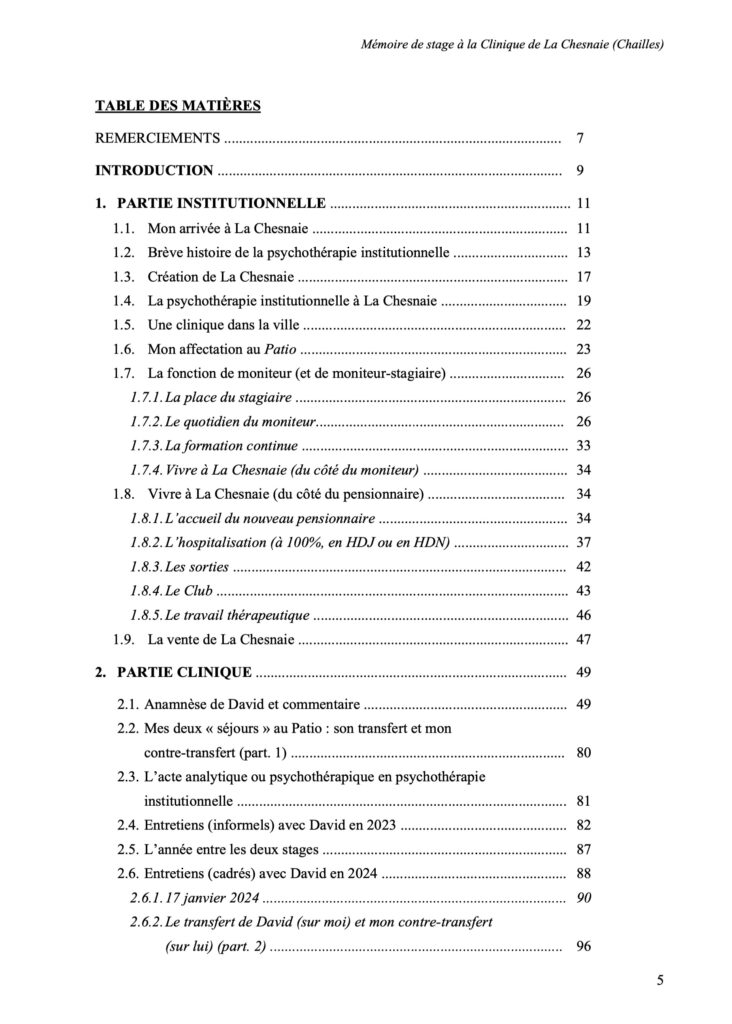
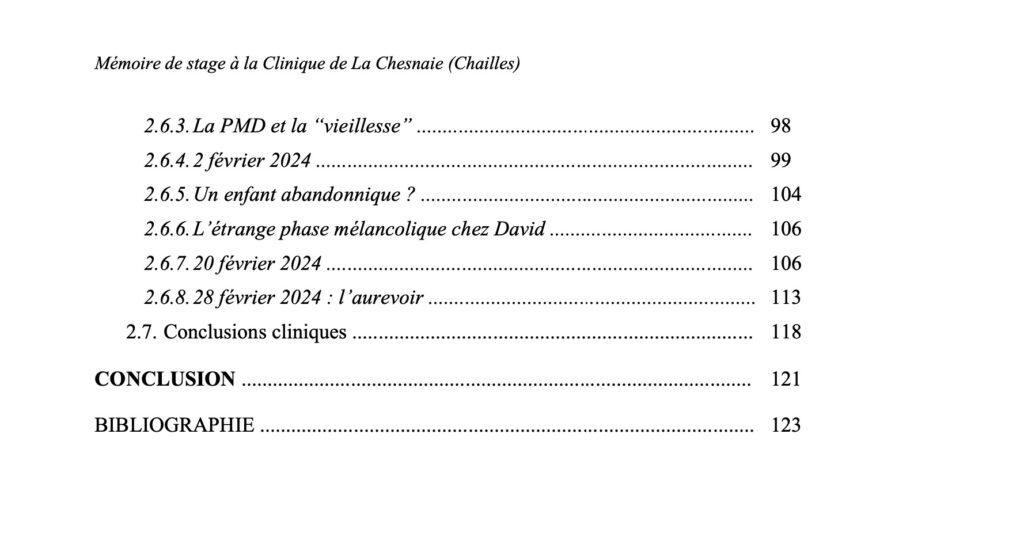
Conclusion du mémoire
Ce stage m’a permis de rencontrer la psychose ailleurs que dans mes livres de psychopathologie. Et alors que j’avais questionné dans mon mémoire de Master la pertinence de maintenir la PMD dans le champ des psychoses (convoquant la psychose ordinaire de Jacques-Alain Miller), j’ai remarqué chez David (mais aussi chez Béatrice et Aïcha, deux autres maniaco-dépressives chesnéennes) combien la décompensation maniaco-dépressive était psychotique !
La PMD a en effet quelques singularités par rapport aux autres psychoses : « Elle se différencie [des autres psychoses] par la prévalence de troubles de l’humeur qui l’emportent sur le délire ou les hallucinations ; dans les intervalles libres, on ne retrouve aucun critère du discours psychotique et on pencherait plutôt pour une structure névrotique. » [1]
À la fin des années 90, Jaques-Alain Miller proposait de distinguer les psychoses chêne des psychoses roseau, selon un découpage que nous trouvons intéressant : « Lorsque le symptôme est du modèle chêne quand la tempête arrive, le déclenchement est patent. Lorsque la structure tient plutôt sous l’aspect roseau, que le sujet a élaboré un symptôme en glissade, à la dérive, le cas ne se prête pas à un franc déclenchement. » [2]
Par ailleurs, le cas Joyce permet de distinguer deux forclusions : la forclusion schreberienne qui est une forclusion de droit (« due à l’imposture du père qui usurpe la fonction en professant la loi sur tout ») et la forclusion de fait, joycienne (« due au père raté qui se démet de sa fonction » [3]).
Miller et al. tendent à classer la PMD dans les psychoses ordinaires et donc la psychose roseau. Mais David me semble bien correspondre à la forclusion de droit[4] et à la psychose chêne. Ainsi, si nous continuons de penser que, par ses phénomènes élémentaires, ses intervalles libres, sa névrotisation possible par les suppléances, la PMD reste une psychose à part, nous admettons qu’elle n’est bien ni une névrose, ni une structure intermédiaire.
Nous maintenons cependant l’idée que par les compensations, la connaissance de sa maladie, et surtout la prise d’une place (sociale, intime, familiale, professionnelle), le maniaco-dépressif peut se tenir dans une vie où les décompensions seront réduites (en quantité et en qualité) et qu’il pourra, en plein d’endroits, reconnaître un semblant, voire vivre avec un simili fantasme.
Concernant David, nous croyons que le grand malheur de sa vie aura finalement été de ne jamais trouver sa place : une place qui l’aurait castré. Ainsi, nous nous demanderons, pour conclure, si c’est sa PMD qui l’a tenu éloigné de cette place, ou si c’est l’absence de place qui l’a maintenu dans sa pathologie… La réalité est sûrement composée d’un peu de ces deux hypothèses.
[1] MENARD Augustin, « Troubles bipolaires et psychose maniaco-dépressive », site https://www.lacan-universite.fr.
[2] MILLER Jacques-Alain, « Psychose chêne et psychose roseau », dans IRMA (collectif), La Psychose ordinaire, la convention d’Antibes, Paris : Agalma / Le Seuil,1999, p. 257-277.
[3] BOUSSEYROUX Michel, « Le nœud borroméen. Ce qui s’apprend de Joyce », L’en-je lacanien, vol.23, n°2, 2014, p.83.
[4] Le droit d’occuper une/sa place, niée par son père….