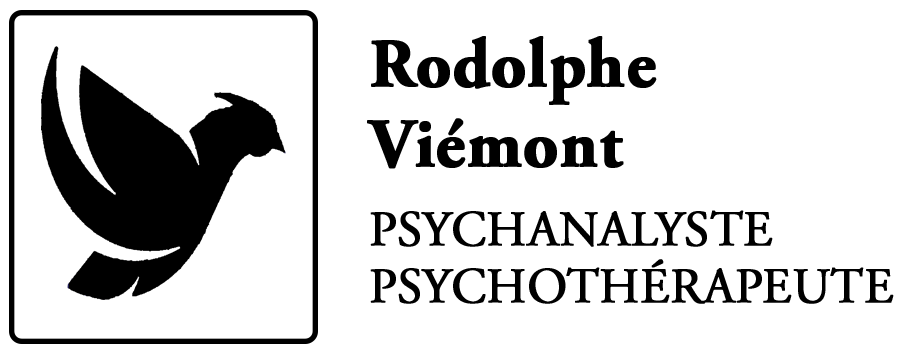par Rodolphe Viémont
Que pourrions-nous dire aujourd’hui de la PMD[1] ? Dans leur manuel de référence (qui fera autorité jusque dans les 50’s), Maurice Dide et Paul Guiraud définissent la PMD comme l’alternance entre une manie (hyperthymie), une mélancolie (baisse généralisée de la thymie) et des intervalles libres. L’hyperthymie se traduit par une exaltation des sentiments, des affects, une hyperactivité motrice et des désordres végétatifs ou organiques. « Le flux d’idées et de mots est divergeant, improductif mais continu et rapide. Le malade parle ou écrit sans cesse. (…) [On voit] un verbiage diffus et incohérent. »[2] La phase mélancolique est en opposition, point par point, à la description maniaque. Mais cette définition presque contemporaine de la PMD, cette lecture manifeste et compréhensive, prend appui sur une nosographie longue et sinueuse.
L’histoire de la PMD commence dans la Grèce antique, au IVe siècle avant notre ère. Dans L’homme de génie et la mélancolie, Aristote décrit le premier la mélancolie qu’il associe à un destin glorieux (« Pourquoi tous ceux qui ont été des hommes d’exception, en ce qui regarde la philosophie, la science de l’État, la poésie ou les arts, sont-ils manifestement mélancoliques ? »[3]), comme s’il affirmait cinq ans avant Arétée de Cappadoce (« Nous voyons que les mélancoliques (…) deviennent facilement maniaques, et lorsque la manie cesse, la mélancolie recommence. ») que la manie (et sa puissance créative) était intimement liée à la mélancolie. Chez les grecs, la folie est une maladie comme les autres, même si on admet que c’est par le cerveau qu’elle se manifeste. La santé est un équilibre (la maladie, un déséquilibre) de quatre humeurs : le sang qui est chaud (caractère jovial), la pituite ou le phlegme qui est froid (caractère flegmatique), la bile jaune qui est associée au sec (caractère colérique), et l’atrabile ou la bile noire associées à l’humide (caractère mélancolique) ; « mélancolie » venant de mélas (« noir ») et khōlé (« la bile »). Selon l’école pneumatiste issue d’Hippocrate, il y a quelque chose dans le corps du fou qu’il faut extraire par émétiques, révulsifs ou purgatifs : tenter d’enlever ce que Rufus d’Éphèse appelle l’humeur peccante, « l’humeur qu’il ne faudrait pas » (traitement qui perdurera via la pierre de folie jusqu’à la Renaissance).
La PMD était donc repérée dès l’Antiquité. C’est pourtant traditionnellement à Thomas Willis (XVIIe siècle) que l’on attribue l’unité des deux folies. Globalement, jusqu’au XVIIIe siècle, on considère qu’il y a quatre variétés de « folies » : la frénésie, la léthargie, la manie (délire sans fièvre, plutôt général) et la mélancolie (délire partiel qui lèse la pensée). Si le Moyen-Âge associe folie et religion (on confondait la folie avec la possession, faisant alors du désenvoûtement une “thérapie” ; cf. Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) « Bienheureux les pauvres en esprit, le Royaume de Dieu est à eux. »), la Renaissance sépare la Raison de la folie (cf. Érasme de Rotterdam et Pascal). La science naît de ce que la Raison est Une comme Dieu est Un. L’aliénisme (le terme « psychiatrie » n’apparaît qu’au XIXe siècle) naît de cela.
Nous assistons alors au grand enfermement (Foucault) : les fous sont enfermés avec les mendiants, les prostituées, etc. (tous ceux qui ne rentrent déjà pas dans la société précapitaliste) dans l’Hôpital Général. L’humanisme des Lumières aboutira à la libération de ces enchaînés… sauf pour les fous que l’on garde enfermés à l’Hôpital Psychiatrique (à Paris : la Salpêtrière, Bicêtre, Sainte-Pélagie). L’État considère que la folie est quelque chose qui le concerne, qu’il y a un traitement collectif de la folie… principe qui perdurera longtemps (et aboutira à la psychiatrie institutionnelle du XXe siècle), amenant l’aliéniste Jean-Étienne Esquirol, élève de Philippe Pinel, à déclarer en 1818 : « Un hôpital d’aliénés est un instrument de guérison. »[4] Ainsi, il est établi que la clinique doit ranger ce que l’on voit, écoute, en maladies, qu’il faut élaborer une symptomatologie. Il s’agit de ramener les insensés passivement (avec le traitement moral) au domaine de la Raison, en les isolant, les traitant. L’aliénisme, et surtout à sa suite la psychiatrie, auront deux obsessions : isoler sur un modèle scientifique les maladies psychiatriques ; et trouver à chacune d’elles une cause anatomopathologique. Esquirol revoit les définitions de la manie et la mélancolie (on classe depuis Pinel la folie en quatre entités : la manie, la mélancolie, la démence et l’idiotisme). La manie d’Esquirol se rapproche de ce qu’est la manie de nos jours : « Le maniaque présente l’image du chaos. (…) Les sensations, les images se présentent à son esprit sans ordre, sans liaison entre elles. »[5] Nous ne sommes plus dans un système hippocratique, Esquirol est un médecin moderne : il sait que la mélancolie, qu’il veut renommer lypémanie, n’est pas une conséquence de la bile noire mais un trouble du système nerveux. Avec Pinel et Esquirol, la folie devient une maladie, objet de science et plus simplement une réflexion philosophique. Mais, on ne sait toujours pas si elle est une maladie organique (délire sympathique) ou une maladie des passions.
C’est en 1854 que la PMD est réellement isolée en rassemblant dans une unique affection manie et mélancolie : Jean-Pierre Falret, tout en prônant l’existence d’un substrat organique à chaque maladie mentale, décrit précisément chacune d’elles et notamment la folie circulaire (« évolution successive et régulière de l’état maniaque, de l’état mélancolique, d’un intervalle lucide plus ou moins prolongé »[6]). Concomitamment (à quelques jours près) Jules Baillarget dépeint lui la folie à double forme. Notons que ce n’est que dans le 11e chapitre de la 8e édition du Compendium de psychiatrie d’Emil Kraepelin (en 1913 donc !) que le terme de « psychose maniaco-dépressive » est affirmée. Ce terme durera jusqu’à la reformulation (seconde moitié du XXe siècle) en « bipolarité ».
C’est alors que Bénédict Augustin Morel amène une lecture de la maladie mentale autour du concept de dégénérescence. Basée sur des conceptions bibliques, qui seront remplacées avec Valentin Magnan par la théorie de l’évolution darwinienne, Morel affirme que les générations s’alternent : des émotifs engendreraient par exemple des alcooliques qui donneraient naissance à de fous… jusqu’à la démence et l’extinction de la lignée. C’est le début de la génétique mendélienne ; nous serions tous plus ou moins prédisposé à la maladie mentale. Cela résonne évidemment très fort avec les recherches actuelles qui affirment que « la génétique pèse pour 60 % dans l’origine des troubles[bipolaires] [même si] ceux-ci ne se déclenchent qu’en interaction avec un ou plusieurs facteurs environnementaux. »[7]… ce que pensait déjà Morel qui estimait qu’il fallait une cause : il pensait alors aux intoxications, au paludisme, aux toxicomanies, etc.
Avec Pinel, Esquirol puis Magan, il y a donc un genre folie, une sorte de Folie unique qui serait divisée en moult folies. Jules Séglas montre lui qu’il y a des entités cohérentes, des maladies à part entière et non des divisions d’une entité Folie. Mais la grande rupture est la conception de maladies de la personnalité : dès Gilbert Ballet, Paul Sérieux et Joseph Capgras, on n’est plus (comme cela avait été le cas jusqu’à Kraepelin) à rechercher une lésion cérébrale, selon le modèle d’étiologie neurologique de la paralysie générale. C. G. Jung parle alors plus d’une autotoxine due à la puissance des complexes : le temps de la psychanalyse est arrivé. Avec elle, on passe d’une maladie objective due à un mécanisme inconnu, à une chose que l’on ne connaît pas plus, qui est l’inconscient, mais que l’on peut liquider par la parole !
Le disciple de Freud ayant vraiment travaillé sur la PMD à travers le champ de la psychanalyse est Karl Abraham : cf. sa conférence[8] du 21 septembre 1911 au 3e Congrès de psychanalyse. La maladie n’est plus une faiblesse, une simple pathologie. Cela concerne chacun d’entre nous : rappelons que la lecture psychopathologique de la normalité se fait à travers celle du névrosé. Mais nous croyons que l’apport majeur de la psychanalyse sur la clinique du mélancolique (et du maniaque par conséquent) est la relation à l’objet telle qu’elle a été développée chez Mélanie Klein puis chez Jacques Lacan. Dans la mélancolie, « le manque (de l’objet perdu) est vécu comme trop radical pour être signifié autrement que comme stase et catastrophe. (…) La faille du recours à l’Autre est tout aussi patente dans la manie, où l’Autre est mis hors-jeu par la fuite des idées (…) et le langage sans adresse, faussement communicatif. »[9]
Cette nouvelle lecture structuraliste de la PMD, en interrogeant la dimension de l’Autre et de l’altérité, plus que d’opposer manie et mélancolie, les rapproche donc sur des positions communes. Mais toute la clinique contemporaine, autour de la notion duelle de « bipolarité », va à l’opposé de cet apport structural. La psychiatrie est aujourd’hui construite autour du DSM, outil de classification et de diagnostic, mais au départ statistique. Le « trouble bipolaire de type I[10] avec épisode maniaque actuel ou le plus récent moyen »… se code désormais 296.42 (F31.12) ![11] Tout est découpé en entités plus petites (c’est Magan à l’excès !). Ne parlons même pas du très à la mode « trouble schizoaffectif de type bipolaire » ! (qui n’est, il faut pourtant l’avouer, pas sans rappeler la non-continuité de l’humeur chez le schizophrène d’Eugen Bleuler). La psychiatrie contemporaine a de nouveau une tendance à rechercher des causes organiques : « Les techniques d’imagerie cérébrale, à travers l’étude de l’anatomie et du fonctionnement du cerveau, ont permis de détecter des anomalies dans certaines zones comme l’amygdale ou l’hippocampe, impliquées dans le traitement des émotions, chez les patients bipolaires même stabilisés. »[12] Le DSM permet en outre d’associer facilement symptômes et molécules thérapeutiques. L’offre a explosé ces 50 dernières années : Tégrétol, Dépakine/ Dépokote, Lamictal et les neuroleptiques de nouvelle génération (Zyprexa, Abilify, etc.) complètent le Téralithe : une pharmacopée de plus en plus efficace qui permet, il faut le dire, d’apaiser les épisodes aigus de la PMD, de maintenir le patient dans un intervalle libre, là où l’altérité revient en place, permettant alors un travail psychothérapeutique voire psychanalytique. Nous jugeons ce travail de la parole fructueux à la mise sous cloche de la PMD, dépassant la simple réponse à tel symptôme par tel médicament. Peut-être un jour arriverons-nous à ce que la parole et la chimie se complètent harmonieusement, sans dogme, dans le seul intérêt du patient…
[1] Nous utiliserons l’acronyme PMD pour psychose maniaco-dépressive dans le reste de ce texte.
[2] Maurice Dide et Paul Guiraud, La Psychiatrie du médecin praticien.
[3] Aristote, L’homme de génie et la mélancolie, Problème XXX.
[4] Jean-Étienne Esquirol, Des établissements des aliénés en France et des moyens d’améliorer le sort de ces infortunés.
[5] Jean-Étienne Esquirol, Des aliénations mentales, tome 2.
[6] Intervention de J.-P. Falret à l’Académie de Médecine, le 14 février 1854.
[7] Cf. travaux de Stéphane Jamain sous la direction de Marion Leboyer, Inserm / AP-HP Henri Mondor.
[8] Karl Abraham, Préliminaires à l’investigation et au traitement psychanalytique de la folie maniaco-dépressive et des états voisons.
[9] Bernard Toboul, Psychose maniaco-dépressive et psychanalyse.
[10] C’est-à-dire avec une manie franche.
[11] Selon la CIM de 9e ou 10e révision.
[12] D’après la présentation de la bipolarité sur le site de la fondation de recherche FondaMental.